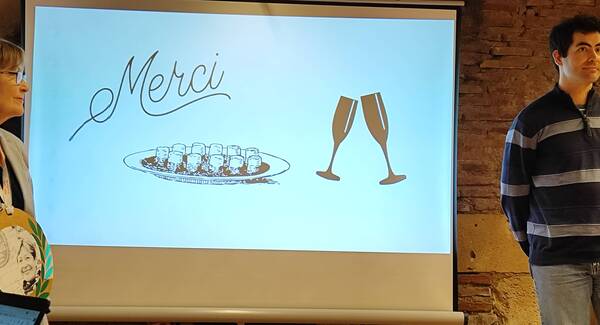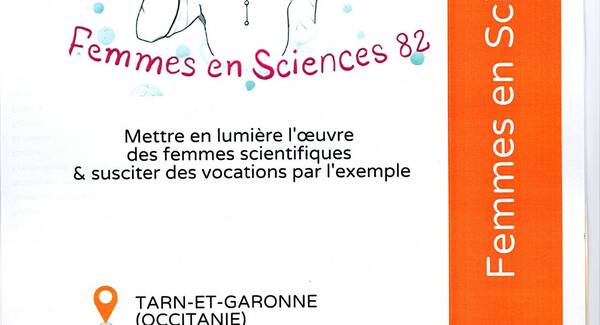Femmes de Science et de Savoir : Savantes bien que femmes [Saison 1 - 3/3]
Publié par Claire Adélaïde Montiel, le 29 mars 2020 1.3k
Lors de la Révolution française, c’est dans la lignée de Poullain de la Barre et de Benito Feijoo que se situe Olympe de Gouges. On retrouve chez cette femme éclairée, tout comme chez Nicolas de Condorcet et Talleyrand, un plaidoyer en faveur des femmes, auquel s’adjoint une revendication pour que soient respectés les droits des minorités.
Femmes ou citoyennes ?

Olympe de Gouges signe une déclaration des droits de la femme sans valeur légale parce que non validée par la Convention. Elle réclame un traitement égalitaire envers les femmes dans tous les domaines de la vie, publics et privés. Ce texte reprend la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à un certain nombre de différences près parmi lesquelles il en est une particulièrement importante. Dans le texte de plusieurs articles, le terme « l’homme » est remplacé par « la femme et l’homme » manifestant ainsi la volonté d’Olympe de lui donner une valeur universelle en refusant de remplacer l’exclusion dont sont victimes les femmes par un nouvel ostracisme.
Une attitude bien propre à conforter ceux qui ayant lu L’esprit des lois de Montesquieu auront compris que les femmes exigeant que soient respectés leurs droits ne partent pas en guerre contre les hommes. « L’empire que nous avons sur elles est une véritable tyrannie. Elles ne nous l’ont laissé prendre que parce qu’elles ont plus de douceur que nous et par conséquent plus d’humanité et de raison. Ces avantages, qui devraient leur donner la supériorité sur nous si nous avions été raisonnables la leur ont fait perdre parce que nous ne le sommes point… Nous employons toutes sortes de moyens pour leur abattre le courage. Leurs forces seraient égales si leur éducation l’était aussi »
Nicolas de Condorcet milite pour qu’on donne aux femmes le droit de vote. Inutile de dire qu’il ne sera pas entendu. Le 22 décembre 1789 l’abbé Sieyès fait la différence entre les français actifs et passifs au nombre desquels il compte, les femmes, les enfants, les délinquants de toutes sortes. En 1791 la Constituante confirme cette exclusion et le 24 juillet 1793 la Convention nationale la réitère.

Les Françaises devront attendre 1945 pour devenir des citoyennes. Une aberration que ne manquera pas de souligner Victor Hugo presque un siècle après la Révolution et un siècle avant cette décisive avancée : « Dans notre civilisation, c’est douloureux de le dire, il y a une esclave. La loi a de ces euphémismes : elle l’appelle une mineure ! Cette mineure selon la loi, cette esclave selon la réalité, c’est la femme. Dans notre législation, la femme ne possède pas, elle n’este pas en justice, elle ne vote pas, elle ne compte pas, elle n’est pas. Il y a des citoyens, il n’y a pas de citoyenne. C’est là un état violent : il faut qu’il cesse. »
L’esclavage est rétabli
Le mouvement d’émancipation des femmes, amorcé au XVIII° siècle, se brise sur les diktats de la Révolution française. L’article de la constitution qui leur est consacré confirme leur sujétion: « Toutes les instructions données aux élèves dans les maisons d’éducation publique tendront particulièrement à préparer les filles aux vertus de la vie domestique et aux talents utiles dans le gouvernement de la famille. »
La devise de la République française : Liberté, Egalité, Fraternité qui figure en bonne place dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 évoque une fraternité et une égalité universelles. Mais, comme le souligne Réjane Sénac, politologue, dans son livre : les non frères au pays de l’égalité[1], n’est pas frère qui veut. Les femmes qui constituent la moitié de la population et les non blancs dont le travail dans les colonies enrichit la nation sont exclus de ce généreux mouvement.
Les cahiers de doléance s’étaient pourtant fait l’écho des espoirs féminins lorsque les femmes au début de la Révolution, ont vu s’ouvrir, pour très peu de temps l’espace public. Elles ont alors investi les tribunes, ont participé aux débats et aux revendications sociales. Leurs demandes concernaient l’instruction, le besoin en sages-femmes, l’institution du divorce, le droit de vote. Mais, aux côtés des hommes dans les combats, elles ont été bientôt renvoyées dans leurs foyers, interdites de rassemblement et traitées comme une race inférieure.

Un homme et une femme soulignent chacun à leur manière, à deux moments de notre histoire, cette situation ubuesque. Manon Roland, salonnière et personnalité politique, avant d’être guillotinée en 1793, exprime le 15 juillet 1791 un vrai désespoir : « Nous ne sommes plus en 1789. On nous a préparé nos chaînes », et quelques siècles plus tard, le poète martiniquais Aimé Césaire formule la même déception avec cette force d’expression dont seuls sont capables les poètes : « Les non-frères renvoient à des citoyens non pas à part entière mais entièrement à part ».

Sous l’Empire, l’esclavage est rétabli. Quant à la condition féminine, elle ne sort pas indemne de cette affaire. Ce qui était autrefois une réalité coutumière, à savoir la soumission de la femme à son époux, est désormais inscrit dans le droit national. Le code civil confirme les femmes dans leur rôle d’éternelles mineures dont la mission essentielle est la procréation : « Faire des fils à leurs époux , c’est encore la fonction que leur assigne le Code civil promulgué en 1804 ». [2]

A la fin du XIXe siècle Le vocabulaire reflète la misogynie institutionnelle que la République a instituée « en toute innocence et bonne conscience » selon les termes de Benoîte Groult[3]. On est loin de la proposition de Stuart Mill, l’auteur de l’essai sur L’asservissement des femmes, qui fit scandale en préconisant à la Chambre des Communes en 1867, le remplacement du mot man par celui de person, réforme du vocabulaire qu’il considère comme inséparable de la nécessaire évolution des mentalités.[4]

Savantes bien de femmes.
Certes, désormais on n’insulte plus, comme au temps de Molière, celles qui se piquent de savoir du nom de « femmes savantes ». Mais, face aux exceptions que constituent les femmes ayant réussi, malgré tous les obstacles, à s’illustrer, on dit : savante bien que femme.
On peut citer trois exemples significatifs de cet état de choses.
Sophie Germain bien que femme, après deux essais infructueux, obtient enfin le prix de l’académie pour son étude sur les surfaces élastiques. Mais le jour où elle doit recevoir sa récompense à l’Académie des sciences, elle est la seule absente. Dans la nombreuse assemblée réunie pour l’occasion, on s’interroge. Quelle mouche a piqué la lauréate ? Le journal des Débats du 8 janvier 1816 fait état de cette absence inexplicable. On a tort de se poser tant de questions. La raison de cette incroyable défection est toute simple : le secrétaire de l’Institut a tout bonnement oublié de lui envoyer l’invitation qui lui aurait permis d’entrer. Pour Freud, quelques décennies plus tard, cela s’apparentera à un acte manqué.
A la mort d’Ada Lovelace, précurseuse avec un siècle d’avance, de l’informatique et dont les écrits, en marge de ceux de Charles Babbage annonçaient l’émergence de l’intelligence artificielle, une bonne âme, voulant la célébrer, s’exprime en ces termes « Outre une intelligence complètement masculine dans sa solidité, sa pertinence et sa fermeté, Lady Lovelace avait toutes les délicatesses du plus raffiné des caractères féminins »

Anne Chopinet, qui sort major de Polytechnique en 1972, la première année où les filles y sont enfin acceptées presque deux siècles après la création de cette prestigieuse école, et la première en mathématique de surcroit, s’entend interroger par un journaliste non pas sur son parcours scientifique ni sur les difficultés qu’elle a pu rencontrer pour parvenir à ce magnifique résultat mais sur ses goûts en matière de mode. Est-ce que vous courez les magasins ? Est-ce que vous vous occupez un peu de vous ? ça vous arrive de vous surprendre dans une glace ? Toutes questions qui, faisant l’impasse sur son savoir, la ramènent à sa nature de femme.
Ce machisme si répandu et d’autant plus nocif qu’il est totalement inconscient, certaines femmes et non des moindres, se révèlent capables de le désamorcer au moyen de l’humour. Ainsi de Marie Curie, deux fois prix Nobel, qui s’entend demander par un journaliste plus naïf que nature : « Qu’est-ce que cela fait d’épouser un génie ? » et qui, au lieu de fulminer, lui répond : « Allez donc le demander à mon mari. »
En fait, à l’orée du XX° siècle, comme le souligne la professeure d’université Pilar Perez Canto: « En dépit des changements, la société patriarcale a continué à s’appuyer sur la famille comme pierre angulaire et à maintenir la fiction d’un pater familias unique responsable du bien-être et du gouvernement de celle-ci et ce, même dans le cas où les femmes ont contribué par leur travail de façon décisive à la maintenance du foyer »[5].
Le corps des femmes ne leur appartient toujours pas. Elles restent d’éternelles mineures auxquelles la société refuse la citoyenneté. Quant à la religion, elle les prive du droit au divorce, à la contraception et à l’avortement. Celles qui souhaitent se réapproprier leur corps ont à subir les foudres des différentes églises et l’opprobre sociale.
Une situation désespérée ? Pas si vite !
[1] Réjane Sénac : les non-frères au pays de l’égalité. Les Presses de France
[2] Le long chemin vers l’égalité. Journal du CNRS N°242. Mars 2010, VI
[3] Benoîte Groult : le féminisme au masculin
[4] Cité par Benoîte Groult dans le même ouvrage
[5] Pilar Pérez Canto. La société patriarcale dans le discours éclairé. Presses universitaires de Paris Nanterre