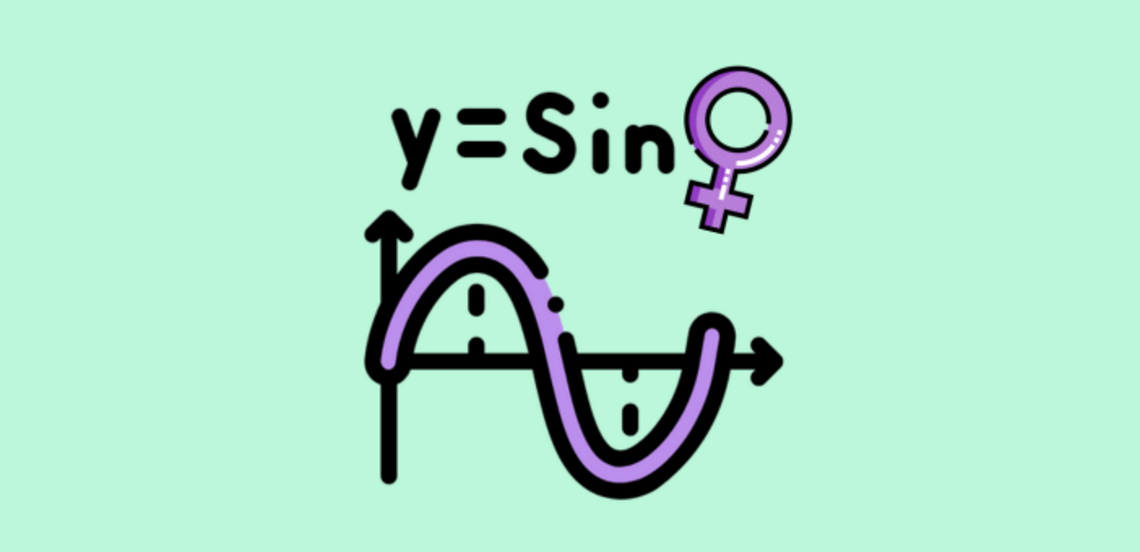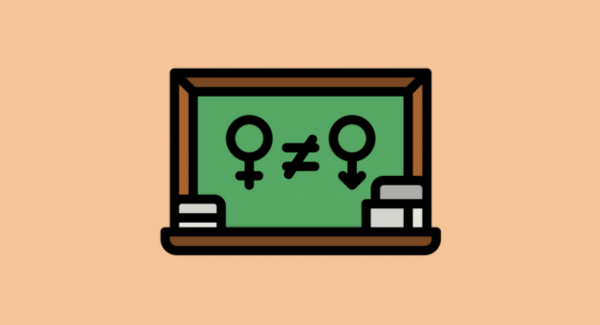Pourquoi y a-t-il si peu de filles en mathématiques ?
Publié par Mondes Sociaux, le 14 février 2025 610
Article de Clémence Perronnet
Aujourd’hui, une fille sur deux n’étudie plus les mathématiques en terminale, contre seulement
un garçon sur quatre. Leur présence chute à mesure que l’on progresse
dans les études supérieures : elles sont entre 20 et 30 % à
l’université, dans les grandes écoles et en doctorat, mais il n’y a que
14 % d’enseignantes-chercheuses en mathématiques. En
2019, la réforme du lycée de 2019 a accentué et mis en évidence un
phénomène aujourd’hui bien documenté : l’absence des filles dans les
filières, les études et les carrières en mathématiques. Mais comment
comprendre cette disparition progressive ?
Loin des idées reçues sur les capacités, le manque de confiance en soi ou l’auto-censure des filles, l’approche sociologique permet d’expliquer comment ces inégalités se construisent à l’adolescence. L’enquête réalisée auprès de 45 lycéennes de 16 ans amatrices de mathématiques montre que leur rapport à cette discipline est la conséquence de traitements inégaux qui les excluent progressivement de ce domaine particulièrement élitiste.
À l’école, le sexisme de l’intelligence
Un premier résultat sociologique important sur les rapports des filles aux mathématiques est que leur expérience scolaire de cette matière est celle d’une inégalité de traitement majeure : à capacités et performances égales, elles ne sont pas considérées comme aussi « intelligentes » que les garçons. Bien qu’il existe un consensus, en sciences de la nature comme en sciences sociales, sur le fait que le sexe biologique ne détermine pas les capacités cognitives, ces idées reçues ont la vie dure.
Au lycée, cela se traduit par un paradoxe : alors que les filles réussissent mieux et sont les meilleures élèves, elles ne sont pas pour autant perçues comme les plus « brillantes » en maths. Cela s’explique par le fait que les jugements scolaires ne se limitent pas aux notes, mais portent aussi sur l’attitude des élèves et la façon dont les résultats sont supposément obtenus. Or, ces éléments sont avant tout déduits de l’origine sociale et du sexe. Les élèves jugés en difficulté irrémédiable ne sont pas forcément ceux qui ont les moins bonnes notes, mais plutôt les élèves des milieux défavorisés, et les élèves jugés les plus intelligents ne sont pas forcément ceux qui ont les meilleures notes, mais plutôt les garçons. Sur les bulletins scolaires par exemple, des élèves aux résultats égaux en maths ne reçoivent pas les mêmes commentaires : les filles ont davantage de retours positifs sur leur attitude et leurs efforts (« volontaire », « appliquée », « studieuse », « consciencieuse », etc.) mais les garçons sur leurs aptitudes intellectuelles (« curieux », « intuitif », « intéressé », « rigoureux », etc.).
Le « manque de confiance en soi » : une rhétorique qui dissimule les discriminations
Dans la presse comme dans les discours éducatifs, l’absence des
filles en maths est souvent justifiée par leurs attitudes : « Elles
n’osent pas », « Elles limitent leurs ambitions », « Elles boudent les
maths », « Elles s’interdisent certains métiers », « Elles manquent de
confiance en leurs capacités », etc. L’enquête auprès des adolescentes
montre qu’elles ont bien intégré cette rhétorique et se l’approprient :
mêmes les plus excellentes élèves déclarent douter d’elles-mêmes, être
angoissées ou se mettre la pression « toutes seules ». Ainsi désignées
responsables du problème, les filles devraient aussi en être la
solution, en « osant » davantage. Ces discours empêchent pourtant de
poser une question cruciale : comment les filles perdent-elles confiance
en elles-mêmes ? [...]
Lire la suite sur Mondes Sociaux

Illustration d’Adèle Huguet pour Mondes Sociaux : licence CC BY-NC-ND
Crédits image de mise en avant : Icône de Freepik - Icône de Freepik