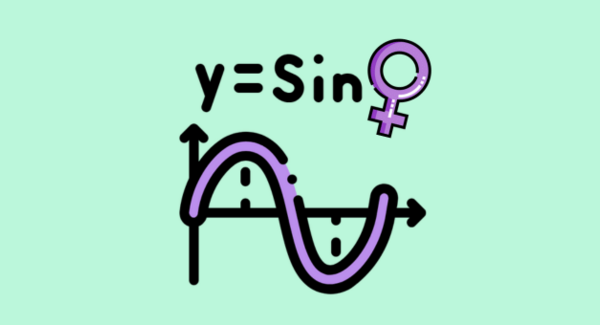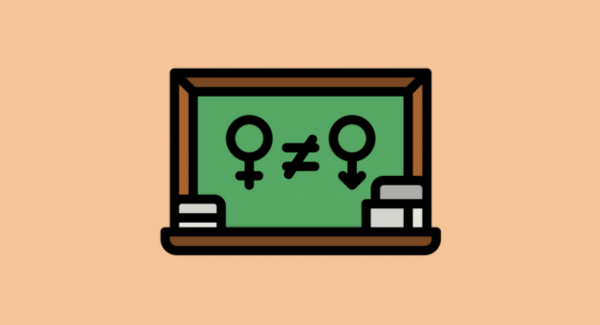L’université de Toulouse et ses premières universitaires (1912-1955)
Publié par Mondes Sociaux, le 12 février 2025 200
Article de Caroline Barrera
Si on tolère les femmes comme étudiantes dans les amphithéâtres dès la fin du XIXe siècle, il n’en va pas de même pour les enseignantes, qui non seulement arrivent plus tard mais demeurent peu nombreuses dans les facultés françaises. Qu’en est-il à Toulouse ? Comment les femmes parviennent-elles à intégrer les différentes facultés ?Est-ce par leur ouverture, par un effet de système ou par la pression des évènements extérieurs ?
L’Université de Toulouse, créée au Moyen Âge, refondée en 1806-1808 dans le cadre de l’Université impériale avec cinq facultés (droit, lettres, sciences, théologie catholique et théologie protestante). bénéficie du vaste mouvement de modernisation impulsé par les réformateurs de la Troisième République. En 1891, elle récupère sa faculté de médecine et en 1896 redevient « l’Université de Toulouse ». Ce mouvement de modernisation va-t-il jusqu’à inclure des femmes dans les différentes catégories de personnel (aides, assistants, chefs des travaux, professeurs sans chaire, à titre personnel ou titulaires de chaire) à une époque, avant la loi Faure de 1968, où la gouvernance des facultés ne relève, en interne, que des professeurs ? Toulouse a effectivement une première titulaire de chaire, Marthe Condat, en 1932. Mais, elle reste la seule pendant très longtemps.
La faculté des lettres et ses enseignantes en langues
En lettres, les femmes sont présentes depuis le début des années 1920, cantonnées dans trois statuts : celui de secrétaire-enseignante à l’institut normal d’études françaises (INEF, ancêtre du département de français langue étrangère), celui de lectrice de langue étrangère et celui des professeures agrégées du secondaire qui arrivent à la Libération. S’il était fréquent, depuis le XIXe siècle, que les professeurs agrégés des lycées assurent des cours à la faculté, il n’en allait pas de même pour les femmes. Ce n’est qu’à la Libération que ce verrou saute quand Émilienne Demougeot (1910-1944), alors professeure agrégée d’histoire, remplace au pied levé William Seston en histoire ancienne. Il est probable que les liens qu’elle avait noués dans la Résistance avec le doyen Paul Dottin aient facilité ce recrutement. Elle est suivie par Mme Rives, docteure et professeure au collège de Cahors en anglais et par Simone Runacher, agrégée d’allemand. [...]
Lire la suite sur le site de Mondes Sociaux
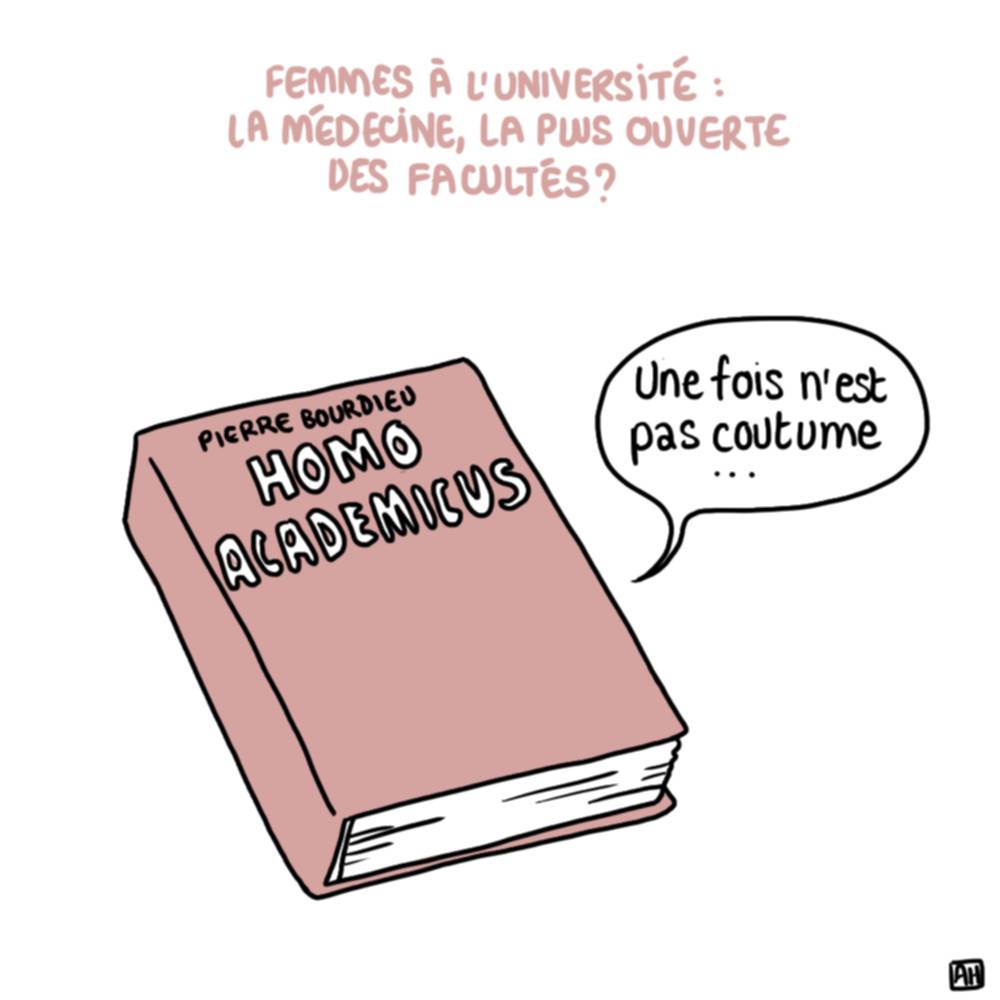
Illustration d’Adèle Huguet pour Mondes Sociaux : licence CC BY-NC-ND
Crédits image de mise en avant : Icon by Slamlabs